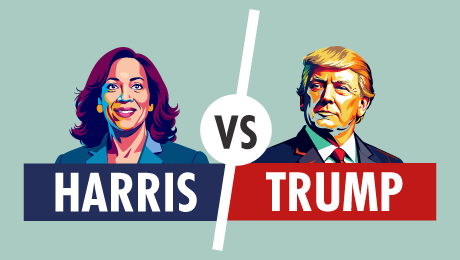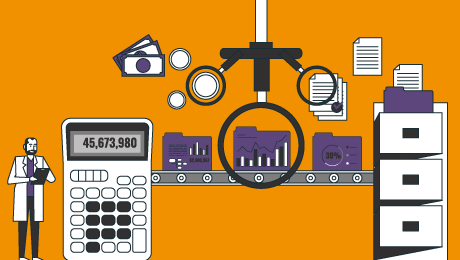Droits de douane : des mesures inédites contre tous les pays
La réforme tarifaire envisagée couvre l’ensemble des pays exportateurs vers les États-Unis. Parmi eux, la Chine, le Cambodge et le Vietnam figurent en bonne position sur la liste des nations particulièrement concernées. La spécificité de la situation chinoise mérite une attention particulière : la maison blanche annonce en effet un taux de 34 % qui s’ajoute aux 20 % déjà en vigueur, portant ainsi le total des droits de douane à 54 %. Il s’agit donc d’une véritable déclaration de guerre commerciale contre le géant asiatique, déjà en situation délicate de surproduction. Le Vietnam et le Cambodge, nouveaux pays industriels cruciaux dans le commerce international, sont frappés de droits exorbitants : 46 % et 49 %, respectivement. L’Union Européenne s’en tire un peu mieux, avec une taxe de 20 %.
Dans une illustration frappante de l’universalité de la mesure, même les îles Heard et McDonald, occupées exclusivement par des manchots et des otaries de Kerguelen, font l’objet de droits de douane. Des territoires français, comme la Réunion ou la Polynésie, sont considérés comme indépendants, et se voient appliqués des droits de douanes différents de ceux pour la métropole.
Les répercussions de l’annonce ne se font pas attendre sur les marchés financiers. Le dollar s’est fortement déprécié depuis l’annonce. Les indices boursiers ont également réagi : le S&P 500 a perdu plus de 4 % au cours de la journée. Selon certains commentateurs, ces baisses, encore contenues, pourraient indiquer que les marchés interprètent ces mesures comme transitoires.
Une méthode de calcul controversée
Mais alors, pourquoi ces chiffres ? Le Président Trump présente ces droits de douanes comme « réciproques », c’est-à-dire en réponse à des droits de douanes et autres barrières réglementaires, selon un principe « œil pour œil, dent pour dent ». Très vite après l’annonce, de nombreux économistes ont réagi, remettant en cause les chiffres annoncés le président. Il est clair, par exemple, que le Vietnam n’impose pas des droits de douanes à hauteur de 90 % sur ses importations américaines.
Les services de presse de la Maison Blanche ont expliqué le calcul : plutôt que d’estimer les valeurs des droits de douanes effectifs imposés par les partenaires commerciaux des États-Unis, l’équipe présidentielle a fait bien plus simple : elle a calculé un simple ratio de déficit :
Il s’agit donc en fait d’un indicateur de « déséquilibre extérieur » par pays. Autrement dit, le statut de fournisseur que certains ont acquis vis-à-vis des États-Unis, comme le Cambodge ou le Vietnam, se retourne contre eux. De même, le Lesotho, l’un des pays les plus pauvres du monde (et donc peu capable d’importer des biens américains) se voit infliger des droits de douanes de 50 %.
Cette mesure de fixation des droits de douanes a laissé la communauté universitaire circonspecte. Thomas Sampson, professeur associé d’économie à la London School of Economics, qualifie cette formule de « prétexte pour l’obsession malavisée de M. Trump concernant les déséquilibres commerciaux bilatéraux » et indique qu’elle ne repose sur aucune justification économique tangible. John Springford, économiste international au Centre for European Reform, va même jusqu’à décrire ce dispositif comme une « recette pour frapper les pays plus pauvres » qui, en fin de compte, verrait leurs excédents commerciaux se déplacer vers d’autres économies fragiles produisant des biens à faible valeur ajoutée.
L’objectif affiché par Trump est clair : réduire le déficit extérieur, qu’il considère comme l’ennemi numéro un de l’économie américaine. Cependant, la majorité des économistes s’accordent pour dire que ce déficit n’est pas intrinsèquement néfaste. En réalité, il résulte en grande partie du statut du dollar en tant que monnaie de réserve internationale, ce qui favorise des déséquilibres commerciaux structurels. En somme, les Etats-Unis fournissent du dollar au monde, et le monde leur fournit des biens. Par conséquent, l’idée de viser une neutralisation totale des déficits commerciaux apparaît non seulement comme techniquement infaisable mais aussi idéologiquement erronée.
Des droits de douanes contreproductifs ?
De nombreux économistes se montrent sceptiques quant aux bénéfices attendus de cette vague tarifaire. Olivier Blanchard, figure reconnue dans le monde de l’économie, observe que l’augmentation des droits de douane pourrait initialement engendrer une réduction des importations et une stimulation temporaire de la demande pour les produits nationaux, contribuant ainsi à réduire le déficit commercial. Cependant, il alerte sur les conséquences perverses d’un tel dispositif. En effet, pour contrôler la hausse de la demande, la banque centrale feraient monter les taux d’intérêt, ce qui entraînerait une appréciation du dollar et, par ricochet, une perte de compétitivité des exportations américaines. Au final, les droits de douanes n’auraient pas d’effets positifs de long terme, inciteraient une mauvaise allocation des ressources productives, et provoquerait de l’inflation.
En effet, le consensus scientifique tend à conclure que c’est avant tout le consommateur américain qui paierait les droits de douanes (via des prix plus élevés). Les droits de douanes doivent être utilisés avec parcimonie, pour protéger ou développer des industries stratégiques domestiques.
Une certaine prise de conscience des risques inhérents à une guerre commerciale semble apparaitre chez les ménages américains. Un sondage Gallup révèle que 81 % des Américains perçoivent désormais le commerce extérieur comme une opportunité pour la croissance du pays, contre seulement 60 % à la fin de l’année dernière. Les droits de douanes, s’ils sont appliqués et provoquent de l’inflation, pourraient vite se révéler hautement impopulaires.
Une résistance qui se structure en Europe et en Chine
Face à cette nouvelle donne, une résistance politique et économique se constitue déjà. En Europe et en Chine, plusieurs signaux attendus se concrétisent : les gouvernements et les institutions se mobilisent pour envisager des contre-mesures et maintenir l’accès à leurs marchés. La Commission Européenne pourrait annoncer sous peu un certain nombre de mesures, cherchant un équilibre entre levier de pression et désescalade. À l’inverse, la Suisse, traditionnellement neutre dans le domaine commercial, adopte une stratégie opposée : ne prévoir aucune contre-mesure, en espérant faire retomber le conflit.
Ce jeudi après-midi, le président Emmanuel Macron recevait les représentants des filières impactées par ces nouveaux droits de douane. Il déplore une « décision brutale et infondée », et appelle à suspendre les investissements privés aux États-Unis pour le moment.
Une question centrale demeure : le président Trump agit-il de manière transactionnelle ou transformationnelle ? Autrement dit, est-il véritablement prêt à supporter les conséquences d’une restructuration complète de l’économie américaine, ou utilise-t-il simplement cette mesure comme levier pour obtenir des concessions de la part de ses partenaires commerciaux ? Dans ce bras de fer, Scott Bessent, secrétaire au Trésor, conseille à tous les pays « de ne pas riposter ». Les prochains jours seront en la matière très instructifs.