Perception de l’argent dans l’histoire
Dans l’histoire du monde occidental, la « réhabilitation » du prêt à intérêt et du négoce a été conduite par une approche morale avant de l’être sur le terrain économique.
Réhabilitation morale de la richesse
En remettant l’ensemble des activités profanes sous la responsabilité humaine, la Réforme a rompu avec l’argument selon lequel les gains des préteurs d’argent et des marchands supposent une hypothèque sur le temps qui n’appartient qu’à Dieu. D’une façon plus générale, le Calvinisme fait de l’homme qui épargne et qui accumule de la richesse un signe d’élection (Max Weber 1904/1905).
La réhabilitation de la volonté d’enrichissement est également conduite sur un autre terrain moral, celui des passions. Dans L’Avare (1668), Molière s’attaque à la passion de l’or qui accapare toute l’étendue du désir d’Harpagon et ne laisse place ni à l’amour de Dieu, ni à celui des siens. Au siècle suivant, les hommes des Lumières réhabilitent l’argent sur ce terrain même où il avait été condamné. Passion « paisible » et « froide » elle permettrait de réfréner celles qui sont source de violences et de guerre (l’ambition, l’amour du pouvoir, le fanatisme religieux). Montesquieu parle du « doux commerce » qui pacifie les relations entre les sociétés ; Voltaire y voit un nouveau fondement universel : « Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion ».
Réhabilitation économique de l’argent
A cette même époque la réhabilitation se situe aussi sur le terrain économique. En 1776, l’Écossais Adam Smith, lui aussi homme des Lumières et fondateur du libéralisme économique, proclame que l’individu à la recherche de l’enrichissement illimité produit malgré lui des effets positifs. C’est la fameuse parabole de la main invisible :
« Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il (l’individu) travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler » (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations).
Avant lui, dès le début du 17e siècle, le Hollandais Bernard Mandeville avait illustré dans la Fable des abeilles la thèse de l’utilité sociale de l’égoïsme et des vices privés. La fable raconte l’histoire d’une ruche qui vivait prospère lorsque régnait l’égoïsme, la cupidité, la vanité et la corruption et qui voit s’étendre la misère et la mort lorsque triomphe la vertu. Conclusion : « Le vice est aussi nécessaire dans un État florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une Nation célèbre et glorieuse ». Notons que ceci n’est pas la thèse d’Adam Smith pour qui l’homme est naturellement un animal moral qui n’est pas seulement préoccupé de son intérêt personnel mais est également soucieux du jugement porté sur ses actions et porté à une empathie naturelle à l’égard des souffrances d’autrui.
Laissant de côté la question de savoir si les hommes sont naturellement portés à l’altruisme ou au contraire à la guerre de chaque homme contre tous les hommes (Bauman 2009), on retiendra que le questionnement éthique sur la finance doit interroger son efficacité économique d’ensemble.
Plaçons-nous maintenant dans le cadre actuel de la finance.
Depuis le début des années 1990 et jusqu’à la crise dite des subprimes, les revenus liés à la finance ont explosé. Des rendements continuellement très élevés ont été exigés par les actionnaires des grandes entreprises. Le secteur financier a obtenu une part croissante des profits réalisés dans l’ensemble des secteurs économiques privés. Aux États-Unis, la part des secteurs financiers dans le total des profits du secteur privé s’était élevée à 40 % en 2007, contre 10 % dans les années 1980, alors que ces secteurs ne représentent que 15 % de la valeur ajoutée et 5 % des emplois privés américains (Michel Aglietta 2008).
Des rémunérations considérables sont versées à certains cadres de la finance, en particulier dans les banques de marché et d’investissement (traders, dirigeants, équipes de recherche).
Après le déclenchement de la crise des subprimes en 2007/2008, ces rémunérations, un temps réduites, ont été rapidement rétablies. En 2010, le salaire annuel moyen à Wall Street s’établit à près de 300 000 $ contre 64 00 $ pour le reste des salariés travaillant à New York. Les salaires dépassant le million de dollars sont légion. Le phénomène est moindre en France, mais, dans la tranche des 0,01 % des salaires les plus élevés pour 2007, on trouve 40 % de salariés de la finance, 20 % de chefs d’entreprises et 10 % de sportifs (Olivier Godechot, 2011).
Les arguments échangés pour justifier ou critiquer ces rémunérations s’inscrivent eux aussi sur le terrain moral et sur le terrain économique recoupant dans une certaine mesure les débats fondateurs évoqués plus haut.
Arguments en faveur de ces rémunérations
-
Les banquiers ne sont pas des philanthropes. S’ils payent autant certains de leur traders, c’est parce qu’ils leur rapportent beaucoup plus. Pourquoi alors limiter leurs rémunérations ?
-
L’industrie de la finance est l’une des plus sophistiquées qui soit. Elle requiert des talents uniques.
-
Il existe un « marché du trader » et les stars vont au plus offrant. Une banque qui refuserait de s’aligner sur ces tarifs prohibitifs se priverait des meilleurs talents. Au fond, les traders sont comme de grands artistes ou de grands sportifs. Eux aussi bénéficient de rémunérations considérables.
Arguments critiques de ces rémunérations
-
Quel que soit le domaine d’activité – y compris les domaines sportifs ou artistiques- des rémunérations astronomiques entraînent des inégalités excessives qui nuisent à la cohésion de la société.
-
Le fait que les traders rapportent plus d’argent qu’ils ne coûtent aux banques ne démontre pas l’utilité sociale des activités des traders ; il y a de la sorte un détournement des meilleurs vers des activités pas nécessairement utiles ou en tout cas moins utiles que la recherche, l’industrie…
-
Les rémunérations des traders posent un problème non seulement du fait de leur niveau mais du fait de leur structure. Le système des rémunérations variables (bonus) a pu être considéré comme une des causes de la crise, dans la mesure où il a consisté (parmi d’autres facteurs) à privilégier les paris de court terme sur les marchés et des prises de risques excessifs de la part des banques d’investissement. Ce point mérite d’autant plus d’être souligné qu’il relie le terrain de l’éthique et celui de l’économie. Au moins jusqu’au déclenchement de la crise, les bonus étaient calculés de façon asymétrique : il n’existe pas de malus lorsque l’activité du trader se révèle entraîner des pertes ou s’avère moins rentable.



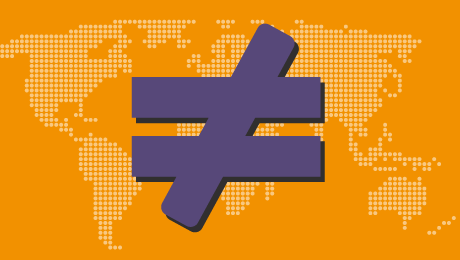
Commenter